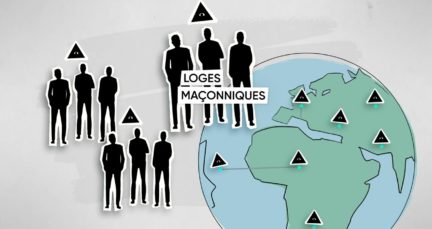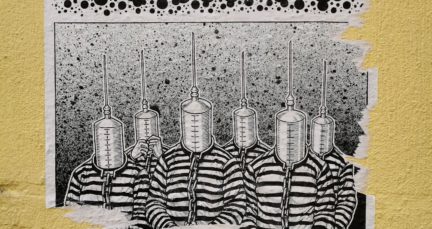Le 15 juillet dernier le Comité interministériel de la laïcité a vu le jour. Il est chargé de piloter la mise en œuvre de nombreuses mesures qui visent à conforter le principe de laïcité. Dans cet ambitieux chantier, l’école est en première ligne. C’est pourquoi un vaste plan de formation de l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale, qui doit se déployer sur quatre ans, a été lancé en septembre dernier. Sans nul doute, l’avenir de la laïcité dépendra pour une bonne part de notre capacité à convaincre la jeunesse – les élèves certes, mais aussi les jeunes professeurs – de sa modernité.
Une laïcité perçue comme discriminatoire et attentatoire aux libertés religieuses
Le défi est redoutable. Car comme le révélait un sondage DDV-Licra publié en mars dernier, une large frange des lycéens d’aujourd’hui perçoit la laïcité comme discriminatoire, envers les musulmans notamment, et attentatoire aux libertés religieuses. C’est le résultat d’un triple phénomène : une offensive anti-laïque orchestrée depuis une trentaine d’années par des éléments radicaux de l’islam et relayée par une partie du monde politique et intellectuel (à l’extrême gauche notamment) ; une invocation dévoyée de la laïcité, à des fins purement électoralistes, par une partie de la classe politique (l’extrême droite en particulier) qui en réclame l’extension à tous les espaces publics (la rue par exemple) ; et un nouveau rapport à la religion, pensée exclusivement au prisme de l’intimité spirituelle et qui interprète toute critique ou limitation de son expression publique comme une atteinte aux droits des individus.
Une laïcité dissoute dans la liberté par ses partisans et ses défenseurs
Il en a résulté, durant les vingt dernières années, une relecture de la laïcité que, dans une dynamique conjointe, ses partisans comme ses adversaires ont fini par dissoudre intégralement dans la liberté. Dans l’espoir de convaincre de ses vertus, pour les premiers ; afin d’assimiler toute restriction imposée ou réclamée en son nom à un acte liberticide, pour les seconds. Or dans un contexte de « reconstruction individualiste de la liberté »Bertrand Badie, « L’Esprit public », France culture, 29 août 2021., force est de l’admettre : il est d’autant plus aisé pour ses opposants d’accuser la laïcité de n’être qu’une mystification républicaine, qu’il est moins commode pour ses défenseurs de soutenir les motifs du bornage des libertés religieuses.
La séparation des Églises et de l’État, finalité primordiale
Mais l’équivalence de la sorte exagérément et immodérément tirée entre laïcité et liberté a abouti à faire porter à la première ce qui n’est pas de son ressort. C’est le cas du droit à la critique des religions que rend possible la suppression du délit de blasphème par la loi sur la presse de 1881, qui n’est en rien une loi de laïcité. Dans le même temps est désormais largement évacué du débat public ce qui constitue pourtant le socle et l’accomplissement de la laïcité, à savoir la séparation. Ferdinand Buisson, l’un des pères de l’édifice laïque français au tournant du XXe siècle, l’exprimait avec clarté : « La laïcité intégrale de l’État (…), déclarait-il en 1904, consiste à séparer les Églises et l’ÉtatPropos tenus lors du Congrès international de la Libre-Pensée à Rome, cité par SCOT Jean-Paul, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 205.. » Telle était bien, et telle demeure, la finalité primordiale de la laïcité. La séparation n’est ni un dogme ni une idéologie, mais un dispositif politico-juridique de régulation des rapports entre la puissance publique et les religions. Elle fut initiée et expérimentée dès 1794-1795Les décrets de la Convention du 18 septembre 1794 puis du 21 février 1795 établissent une première séparation de l’Église (au singulier) et de l’État. Le texte de 1794 fixe que « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte ». Cette séparation est réaffirmée par l’article 354 de la Constitution du 22 août 1795. Le Concordat de 1801 met un terme à cette première séparation. par les révolutionnaires désireux de rompre avec une histoire pluriséculaire d’imbrication étroite des pouvoirs temporel (la royauté) et spirituel (l’Église catholique) qu’incarnait le sacre du roi dans la cathédrale de Reims par l’archevêque du lieu. Ce cérémonial politico-religieux qui remonte au Moyen Âge élevait le roi au rang symbolique et politique d’évêque.
La séparation, condition d’émancipation des individus et de réalisation des promesses démocratiques
Reprenant l’œuvre révolutionnaire de séparation interrompue à l’initiative de Bonaparte à partir de 1801, les grandes lois de laïcisation de la IIIe République s’attachèrent donc à tracer des frontières, c’est-à-dire à définir les limites du non-empiètement entre l’État, garant du commun, et les religions, qui n’étant « que de certains », comme l’écrit Henri Peña-Ruiz, ne « peu[vent] s’imposer à tous »Henri Peña-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité ?, Gallimard, 2003, p. 10.. Le premier champ de réalisation de la séparation fut l’école publique, entre 1881 et 1886, avant l’État en 1905. À l’ère contemporaine de la liberté égocentrique, faire comprendre la laïcité requiert que les motifs de ce bornage soient longuement, explicitement et clairement exposés, sans euphémisme ni faux-fuyant. Conscients que les religions sont, aussi, des instruments de contrôle social et mental, et de puissants pôles de conservatismes sociaux et sociétaux, ses promoteurs de la IIIe République concevaient la séparation comme condition d’émancipation des individus et de réalisation des promesses démocratiques. De fait, depuis la Révolution française, nombreuses sont les libertés (individuelles, de création artistique ou de production scientifique) et les égalités (entre les sexes et les sexualités, par exemple) gagnées contre de fortes résistances émanant de la sphère religieuse (qui n’en compte pas moins aussi ses progressistes). Aujourd’hui encore, pour le politiste Jérôme Fourquet, l’une des principales fractures qui divisent la société française se situe dans le « fossé grandissant entre une majorité de la population engagée dans un processus de sécularisation définitif et des groupes (musulmans, évangéliques, catholiques conservateurs) marqués par un revival religieux et porteurs, en matière de mœurs (sexualité, procréation, etc.), d’une vision orthogonale au système de valeurs mainstream »Jérôme Fourquet, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Seuil, 2019, p. 508..
Liberté de conscience et liberté des cultes
Comme le précise l’historien Christophe Bellon, « le but [des promoteurs de la loi de 1905] éta[it] sans ambiguïté la séparation »Christophe Bellon, « Aristide Briand et la séparation des Eglises et de l’Etat. Du travail en commission au vote de la loi (1903-1905) », Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, 2005/3, n°87.. La garantie de la liberté, religieuse en l’occurrence, n’en fut qu’une « condition essentielle »Ibid. de réalisation, une modalité, non sa finalité. L’affirmation du principe de la liberté en matière religieuse dès l’article Ier de la loi de 1905 répondait alors à trois objectifs de nature politique. D’abord, rappeler que la séparation résulte de l’opinion largement admise au début du XXe siècle qu’« il n’est plus possible qu’il y ait un Dieu de la cité »Parti républicain radical et radical-socialiste, Quatrième congrès annuel. Toulouse (octobre 1904), p. 92 (consulté sur gallica.bnf.fr), selon les mots de Ferdinand Buisson devant ses amis du Parti radical en 1904. La séparation signifiait donc que l’État renonçait à imposer une quelconque doctrine en matière religieuse. La liberté ainsi laissée à chacun par la loi de 1905 dérive expressément de ce renoncement. Ensuite, prendre le contrepied du régime des cultes reconnus qui accordait, entre 1801 et 1905, des privilèges symboliques et matériels exorbitants à quatre religions (catholique, luthérienne, réformée, israélite), à l’exclusion des autres – c’est en ce sens que la loi de 1905 est une loi d’égalité. Enfin, et surtout, donner l’assurance aux croyants catholiques que dans le cadre nouveau de la séparation leurs droits seront respectés. Il fallait en effet rassurer ces derniers qui, à l’instar de l’abbé Gayraud, député du Finistère, accusait la gauche séparatiste de vouloir « détruire le catholicisme », « anéantir la religion » et « entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes et israélites »Lors d’un discours prononcé à la Chambre des députés le 21 mars 1905, cité dans 1905, la séparation des Eglises et de l’Etat. Les textes fondateurs, Perrin, 2004, p. 215., tandis que son collègue Boni de Castellane fustigeait « un projet de destruction de l’Église par l’État » et une détermination résolue à « détruire en France la liberté de croyance »Discours à la Chambre des députés le 27 mars 1905, Ibid., pp. 249-250.. L’historien Jean-Paul Scot rappelle qu’Aristide Briand, député socialiste rapporteur de la loi, faisait de « l’impérieuse nécessité de rassurer les “fidèles” catholiques » une priorité « en proclamant que la République s’engageait à respecter et faire respecter la liberté de conscience et donc la liberté des cultes »Jean-Paul Scot, op. cit., p. 7. Aristide Briand s’exprima dans ce sens à la Chambre des députés notamment le 20 avril 1905..
Des libertés religieuses limitées
Faire comprendre la laïcité, aux élèves et aux jeunes professeurs notamment mais pas seulement, devrait par conséquent consister à rappeler qu’il s’agit d’abord et avant tout autre chose d’un régime de séparation, dont la liberté, encadrée, est la modalité privilégiée de sa mise en œuvre (la séparation de 1795 fut moins libérale en ce qui concerne l’exercice du culte). L’équivalence désormais unanimement entérinée entre laïcité et liberté dérive d’une lecture amputée de la loi de 1905, que ce soit délibérément ou par ignorance. L’article qui stipule que « la République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » est le premier du titre I de la loi intitulé « Principes ». Cet article précise que la liberté de culte (c’est-à-dire la manifestation publique des croyances religieuses) ne peut cependant contrevenir aux « conditions » qui assurent « l’ordre public ». C’est pourquoi le législateur avait inséré dans la loi un long titre V composé de douze articles intitulé « police des cultes » et qui pose une série de limites et d’interdictions. Ce en quoi il importe de rappeler que les libertés religieuses ne font pas exception, et que rien ne pourrait justifier qu’elles bénéficient en la matière d’un traitement dérogatoire : toutes les libertés sont encadrées, bornées et régulées, celle de fumer, de consommer de l’alcool, de se dévêtir comme celle de s’exprimer dans un espace public.
Les religions, des forces politiques à réguler
L’enjeu qui sourd derrière les débats sur la laïcité dépasse par conséquent de beaucoup la seule question du for intérieur et de l’intimité spirituelle. Il la dépasse d’autant plus que ces derniers ne sont pas les cibles de la séparation entre les Églises et l’État, contrairement à la grille de lecture de la laïcité que tentent d’imposer ses adversaires et ceux qui font leur jeu. C’est de la religion en tant qu’organisation collective et force politique que la puissance publique laïque entend réguler les manifestations et les expressions. La confusion parfois délibérément entretenue entre les registres implique que la reconstruction du savoir sur la laïcité ne pourra être dissociée et faire l’économie d’un réexamen et d’une (re)construction d’un savoir sur la place, le rôle et les fonctions des religions dans les sociétés, au passé comme au présent.
Benoît Drouot, professeur agrégé d’histoire-géographie